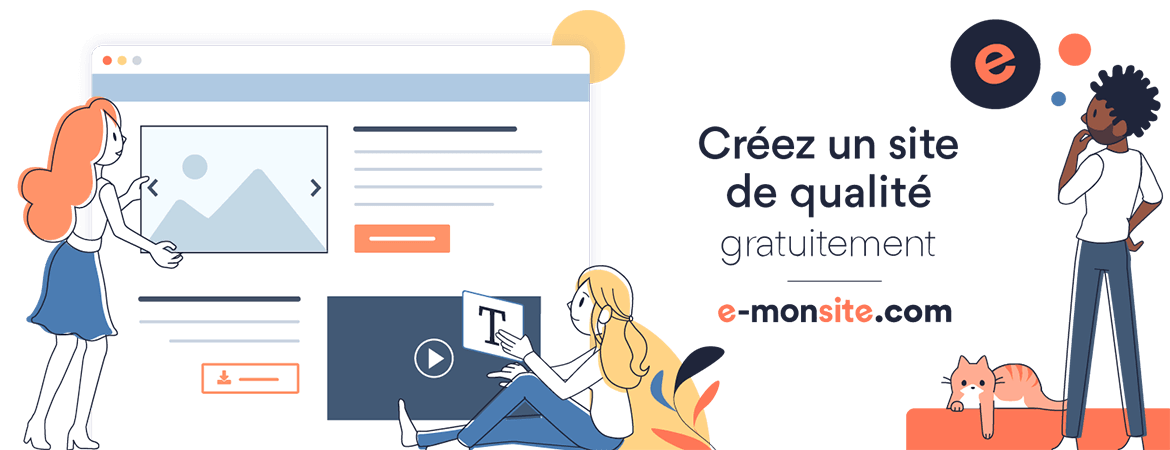Incipit L'Etranger
Un incipit déroutant, qui présente un personnage étranger à toute humanité, dans un univers « absurde »…
I. Un incipit déroutant
- on est à la fois dans un journal intime et dans un compte rendu : avec le récit à la 1ère personne, on s'attendrait, dans un journal intime, à une explosion de sentiments… mais on a plutôt un emploi du temps qui s'attache à lister les formalités liées à l'événement. Les phrases sont simples, presque à l'image du télégramme qui annonce la mort de la mère.
- le cadre spatio-temporel est précisé : on est à Alger, il fait chaud, on sait où situer l'asile… et pourtant les informations temporelles sont plus confuses : la date de la mort de la mère est incertaine, et les connecteurs de temps rendent compte d'une sorte d'hésitation entre futur et passé (il le fera après-demain / il y a quelques mois…) : finalement, on est aussi perdu dans le labyrinthe des informations fournies. Le personnage est tiraillé entre un avenir où il se projette, lorsqu'il est avec son patron, et un passé qui ne cesse d'être précisé. On sait qu'il a pris l'autobus, puis on apprend qu'il a couru pour ne pas manquer le départ…
- la logique du personnage est également surprenante : l'expression de la cause et de la conséquence fait surgir l'impression d'absurde chez le lecteur. « il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille / J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu monter chez Emmanuel »...
- ce début sonne comme une fin. On commence par la mort… et plus spécifiquement la mort de la mère (celle qui donne la vie).
II. Un personnage hors de toute humanité
- l'absence de sentiments et l'écriture proche de la notation rend le personnage presque monstrueux. « il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille » : ce qui est révoltant, c'est que le personnage met au même plan la disparition de sa mère et l'absence au travail. Le banal est traité de la même manière que l'exceptionnel. Comme si l'amour filial, qui perce à travers l'appellation « maman »(et non pas « mère », terme employé par les autres) était refoulé, incapable d'être exprimé…
- dépourvu de sentiments, le personnage est entièrement tourné vers ses sensations. Dépourvu de vie intérieure, son rapport au monde est tourné vers l'extérieur : « Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi » : le toucher, l'odeur, la vue semblent avoir une action directe sur le personnage.
- On peut dire qu'il est étranger à lui-même, il n'agit pas, mais réagit, il subit les événements, et n'a pas vraiment de personnalité. Par exemple, il ne conduit pas, mais se fait conduire. Personnage essentiellement passif, son sommeil peut être symbolique et signifier son inconscience.
- C'est ce que confirme la présence de la société dans cet incipit, société qui apparaît comme une force oppressante et aliénante. Elle apparaît sous 3 formes : le télégramme de l'asile, la figure du patron, et le militaire du bus. Le télégramme est d'une violence rare. Sur le même plan, on a un discours très personnel (mère décédée) et une formule de politesse (sentiments distingués). On peut alors percevoir une forme d'ironie grinçante, dans la mesure où les sentiments exprimés ne peuvent être distingués, ou dans la mesure où le personnage n'a précisément pas de sentiments… et met tout sur le même plan… Les figures du patron et du militaire représentent une autorité implacable : « il n'avait pas l'air commode », « j'étais tassé contre un militaire ». Ils sont anonymes, indéfinis, et se réduisent à leur fonction. Surtout, ils exercent une pression qui amène Meursault à ressentir un sentiment de culpabilité ou de fuite « ce n'est pas de ma faute » / « pour ne plus avoir à parler ».
III. Un univers absurde
la perte du sens : la mort de la mère signe donc la perte des repères du personnage (repères dans le temps, l'espace, la société, la logique…) et fait surgir la notion d'absurde. « Cela ne veut rien dire ». Le langage officiel, qui permet de vivre en société, ne permet pas de saisir le sens de la mort. La société ne peut donner, à travers ses rituels (l'enterrement, le télégramme, le discours stéréotypé des amis)… qu'une « allure officielle » et l'apparence d'une « affaire classée ». Tout discours, devant la mort, devient ironique (sentiments distingués), vide de sens et stéréotypé (on n'a qu'une mère), ou vain (j'ai dit oui pour ne plus avoir à parler). La mort affecte le langage, qui ne permet plus de communiquer. En fait, le sens de la mort ne peut être donné par la société, c'est une expérience intime, intérieure, que le personnage ne semble pouvoir faire. Il apparaît comme une sorte d'anti-héros, mal armé pour affronter le deuil qui ouvre l'oeuvre.
Pourtant, c'est un monde où la mort est partout. Le don du brassard et de la cravate en témoigne : c'est la marque d'une condition humaine tragique. La cravate qui serre le cou et le brassard qui serre le bras sont presque des symboles qui préparent à la mort. La mort est partout, et elle fait surgir l'absurdité de notre condition humaine.
Ajouter un commentaire